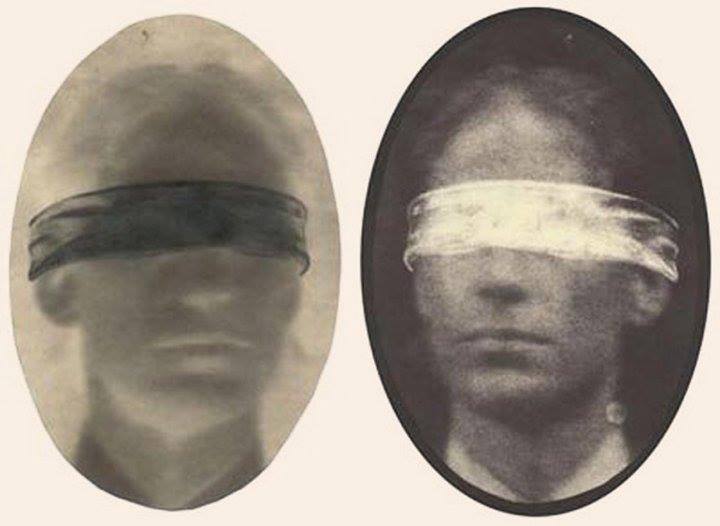
(photo source inconnue)
Chronique Urbaine : Le monde refait à neuf, par Animande
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 La Chronique IllustréePUBLIÉ LE 31/03/2014 à 16 PAR L'URBAIN INCONNU 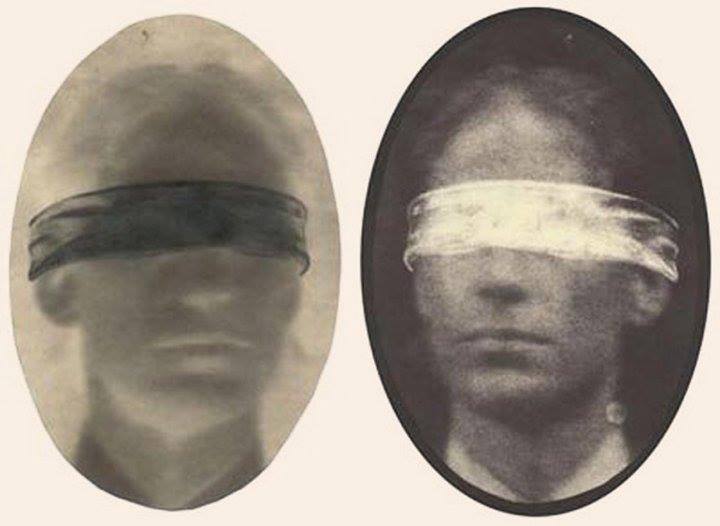 (photo source inconnue) Chronique Urbaine : Le monde refait à neuf, par Animande 0 commentaires Résister à Nice : les nuits urbaines ou le monde refait à neufPUBLIÉ LE 30/03/2014 à 22 PAR AMANDINE BRULéE  Jour après jour, on perd du corps. Travailler, on y va rarement en dansant. Dans les transports en commun, le corps est carrément un embarras. Anesthésié par le mouvement du véhicule, on bouge le moins possible. Autour de nous d'autres corps, pareillement paralysés, avec lesquels on ne fait rien. On s'enfonce dans une musique qu'on est le seul à entendre. Avec le plat du pouce on glisse sur l'écran du téléphone. Les opiacés technologique font passer plus vite ce temps destiné à ne pas être vraiment vécu. Au travail on refait quelques gestes, toujours les mêmes. Notre place on sait où elle est, on l'a bien circonscrite, c'est rare qu'on s'éloigne du siège, du comptoir, de l'estrade qui nous est assigné. Parfois, c'est vrai, à partir de ce point immobile on trouve des astuces pour se déployer. Mais bien souvent l'impulsion manque. On aimerait s'élever, mais sans élan comment prendre de la hauteur. On devient gourmand, pour se consoler. Le long des rayons de supermarchés, on regrette d'avoir passé l'âge de croire aux images qui emballent les plats préparés. Parfois Monoprixxx nous arrache un sourire avec un slogan humoristique. C'est plus vraiment de l'enchantement. Si c'était pas aussi pratique, on ferait peut-être la révolution. Mais le corps est fatigué. C'est même son principal tourment, cette fatigue que les plus longs repos, les décubitus pantouflards agrémentés d'absorption massive d'images semblent impuissant à résorber. L'énergie est la seule chose qui s'amenuise parce qu'on ne la dépense pas. Aux heures où on peut reposer son corps dans le petit cube individuel, il arrive qu'on préfère en sortir, attiré au dehors par des choses qui ne sont ni le travail salarié ni le supermarché. Tout le corps qu'on a perdu dans la journée, on va le regagner le soir en allant se coller à d'autres corps dans des cubes plus grands. On boit, on mange, on discute, c'est pas désagréable, parfois c'est même vraiment amusant. Le lendemain, en allant travailler, on retrouve le monde intact, exactement dans le même état où on l'avait laissé. Et si pour une fois on faisait quelque chose qui ne laisse pas le monde intact ? Nuits Urbaines Les rues de la ville, ces longueurs qu'on a l'habitude de traverser le plus vite possible pour aller d'un endroit à un autre, pour une fois les habiter, les incarner, y errer sans itinéraire arrêté, sans but précis, sans d'autres préoccupations que d'y être et de montrer qu'on a pas eu peur d'y avoir été, debout, mobile, hésitant et présent. Le corps dont la ville si souvent nous dépossède, avec ses foules, ses tunnels, ses voitures, aller le chercher dans ses rues, là où on utilise depuis si longtemps l'espace d'une seule et unique manière, la manière discrète. En chemin pour taguer la ville, on tâtonne. On trie moins bien les informations que d'habitude. On ne sait pas vraiment d'où viennent les dangers. On manque sans doute beaucoup d'occasions. À force de marcher, la ville de béton devient une ville de papier. Alors de tous les morceaux de rue nous pouvons devenir l'auteur. Signer un trottoir. Légender une fenêtre. Raconter un camion. Titrer une porte. Gloser un mur, avec note en bas de compteur électrique. Raturer les noms de villas idiots. Pour une fois écrire la ville, après toutes ces années passées à la lire. Pour une fois se réunir pour quelque chose qui ne sera ni confortable, ni reposant, ni divertissant. Pour quelque chose qui sera excitant, et qui ne suscitera pas l'approbation générale. On repasse dans la rue où on a collé, peint, bombé : impossible de ne pas éprouver une fascination puérile pour son ajout au monde. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y avait rien et, grâce à moi, il y a quelque chose. On espère qu'on ne sera pas le seul à voir ce quelque chose, qu'il existera aussi pour tous les inconnus qui par hasard passeront par là. En réalité, ces traces d'expérience de vie amplifiée, on ne peut être sûr qu'elles ont été vues qu'une fois qu'elles ont été effacées. C'est le paradoxe de cette chose (que je n'ose pas nommer art) : seule sa disparition semble attester de son existence. La certitude de cette destruction rapide réduit un peu l'investissement. Pour poursuivre quand même, il faut : goûter un surcroît de poésie à l'aspect éphémère de la chose. Ou : Trouver un moyen de retarder la destruction. Ou bien, encore : voir l'aspect positif. Régulièrement le stock d'espaces vierges se renouvelle sans qu'il soit nécessaire de fournir le moindre effort. Dégradation, vandalisme : j'assume pleinement cet aspect là du geste. Je ne tague pas pour embellir la ville. Je tague pour irriter, pour incommoder. Tout ce que je me force à faire dans la journée (être polie, ne pas déplaire, ne pas bousculer) n'est pas en mesure de m'attirer dehors aux heures où je peux rester dans mon cube pour reposer mon corps. Le contraire, si. L'intensité à vivre perdue dans la journée, la regagner en partie la nuit, à cette seule condition sortir, à cette seule condition mouvoir mon corps. Quand j'y pense, j'exècre le soin anxieux que nous mettons à nous respecter, pas parce que nous nous trouvons respectables, mais pour être bien sûrs que personne ne viendra nous déranger dans notre enclos. Dessiner une bite sur une boîte aux lettres, c'est ma manière, bête et méchante, de me rappeler que ce qu'on prend pour des propriétés juxtaposées les unes aux autres, c'est d'abord un seul et unique territoire. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça changer le monde ? Parfois, lamentablement, l'être asthmatique, découragé, et fatigué qui est en moi maugrée : « C'est pas ça qui va changer les choses. » Alors je lui demande, à ton avis : À quel moment sait-on que les choses ont été changées ? À partir de combien de feuilles perdues peut-on dire que l'arbre est effeuillé ? Est-ce qu'il en faut mille ? Est-ce qu'il en faut cent ? Est-ce qu'il suffit, tous les jours, en passant dessous, d'arracher une feuille ?
Animande, aux Urbains de Minuit, et de midi
« La mobilisation, au sens le plus littéral de savoir ce qui fait mouvoir les corps, c'est-à-dire ce qui induit les énergies des conatus à faire ceci ou cela et avec quelle intensité » (Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude)
2 commentaires Le 2014-04-15 01:53:15 par Lisa Laisser une trace de soi, dans le monde Dans ce monde qui étais parfait jusqu'à l'arrivée de l'homo "sapiens sapiens" (qui sait quoi enfin) Pour qu'il soit meilleur. C'est un acte d'amour vers le monde, c'est entendre le cri du monde et le faire parler au dessus du béton e des autoroutes. On veut regagner le monde, nous les humaines. Pourquoi pas, d'autant que nous sommes là? |
Est-ce qu'il suffit, deux fois par mois, de lire un article d'Amandine pour changer son regard ?
OUI.